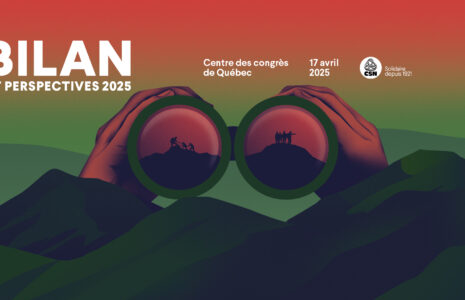Que des hommes et des femmes ne comprennent pas le besoin de se réunir entre femmes démontre bien l’intégration du discours patriarcal. Certaines personnes banalisent ce besoin et revendiquent la transformation des comités de condition féminine en comités de « relations humaines » ou autre appellation du genre. D’autres réagissent en critiquant le manque de reconnaissance des féministes envers la solidarité de plusieurs hommes et les problèmes qu’ils vivent eux aussi (violence, harcèlement, monoparentalité, etc.). Pourtant, bien que les femmes n’aient pas le monopole de la discrimination, elles la subissent plus souvent que les hommes.
On entend souvent dire que l’égalité est acquise et que sa concrétisation ne relève que du bon vouloir des femmes. Un exemple patent est leur sous-représentativité dans les postes politiques. Les femmes autant que les hommes peuvent poser leur candidature à la tête d’institutions politiques ou syndicales, etc. Pour les tenants de cette vision, le manque de volonté des femmes ou leur désintérêt pour la chose politique expliquent un tel déséquilibre.
Certes, les femmes doivent prendre leur place. Mais cette façon stéréotypée d’analyser la situation est issue de centaines d’années passées à entretenir un modèle de société patriarcale bien ancré en nous. Les façons de faire en politique, notamment le recrutement et l’organisation des réunions, ont longtemps été appliquées par des hommes, pour des hommes. Les premières femmes à avoir réussi à se tailler une place dans ce milieu d’hommes devaient se conformer aux pratiques établies, et la critique était prompte et vive envers celles qui ne rentraient pas dans les rangs.
Il est possible de faire les choses autrement et des améliorations notables ont été apportées grâce aux revendications des femmes. L’égalité de droit, du moins au Québec et au Canada, est en grande partie atteinte : la discrimination basée sur le sexe n’est plus acceptable. Mais dans les faits, beaucoup de chemin reste à parcourir, les nombreuses statistiques disponibles sur les écarts salariaux, l’accès aux postes de pouvoir, les responsabilités familiales, la pauvreté, la violence, etc., le démontrent bien.
Les stéréotypes sont encore bien présents dans nos sociétés dites égalitaires. Ils sont insidieux et difficiles à combattre, car ils sont banalisés et font partie d’un mode « normal » de fonctionnement. Cette passivité, cette force d’inertie, met un frein aux revendications féministes. C’est « l’antiféminisme ordinaire ». Il faut que le réflexe de briser les stéréotypes s’acquière. Il faut que cesse la pression sociale qui veut faire entrer les gens dans un moule.
Un espace de discussion entre femmes permet les débats ouverts sur le féminisme qui sont difficiles à faire en groupes mixtes. Les femmes ont besoin de cet espace pour pouvoir faire naître des idées et les porter haut et fort, et s’exprimer sans cette pression intangible, mais bien présente. Tant que l’égalité ne sera pas atteinte, ces espaces « pour femmes seulement » seront nécessaires.
Il faut combattre cette réserve à ne pas se dire féministe, comme l’a fait de façon bien maladroite la ministre Thériault. À la question « Êtes-vous féministe? » plusieurs hommes et femmes répondent « Oui. Mais… ». La crainte d’un féminisme extrémiste n’est jamais bien loin.
Une fois cette prise de conscience effectuée, levons-nous et applaudissons les espaces « pour femmes seulement ». Ils contribuent à briser les mythes, à secouer l’inertie et à ouvrir le chemin à une véritable société égalitaire.