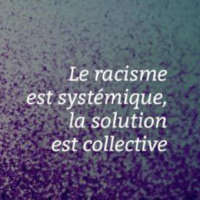Blogue de Jean Lortie
Les problèmes causés par le racisme systémique au Québec et ailleurs en Amérique du Nord ne datent pas d’hier. Dans les faits, la violence engendrée par le racisme et la discrimination raciale fait partie de notre histoire depuis les expéditions de Jacques Cartier et de Samuel de Champlain. D’ailleurs, à titre d’exemple, qui parmi nous connaît l’histoire de Marie-Josèphe Angélique, jeune esclave noire accusée d’avoir provoqué un incendie majeur à Montréal en 1734? Plus de vingt personnes ont défilé devant un juge pour la condamner, même si aucun d’entre eux ne l’avait vue mettre le feu. Reconnue coupable malgré l’absence de preuve, elle sera pendue, et son corps brûlé. Que nos livres d’école ne fassent pas mention du drame de Marie-Josèphe témoigne des lacunes flagrantes quant à la capacité de nos institutions à refléter un portrait complet de notre histoire collective, et pas uniquement celui des descendants de souche européenne.
Voilà l’une des raisons pour laquelle plusieurs groupes, dont la Confédération des syndicats nationaux, réclament la tenue d’une commission parlementaire sur le racisme systémique, car près de 300 années après l’exécution de Marie-Josèphe, il reste beaucoup de chemin à parcourir en ce qui concerne les questions de discrimination raciale. Il ne faut pas chercher très loin pour trouver des exemples de ce que subissent les communautés racisées : attaques et vandalisme islamophobes à Sherbrooke, saccage d’une mosquée à Sept-Îles, allégations d’agressions de la part d’agents de la Sûreté du Québec (SQ) envers des femmes autochtones à Val-D’Or, banderole anti-réfugiée à Québec, et, bien sûr, la tuerie récente à la mosquée de Sainte-Foy. Qu’on pense aussi au profilage racial et à la discrimination systémique que subissent les jeunes racisés de la part des forces policières et qui ont été documentés par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Afin de combattre les effets toxiques du racisme, le gouvernement doit privilégier l’éducation populaire auprès de l’ensemble de la population et démontrer une volonté de réformer les institutions sur lesquelles repose notre société.
Affronter le racisme dans les milieux de travail
L’aspect systémique du racisme au Québec témoigne d’une crise majeure qui se répercute dans toutes les sphères de notre société et de ses institutions. Souvent, la conversation sur le racisme se limite aux aspects policiers ou juridiques, mais le racisme s’étend bien au-delà de ces questions.
Une sortie récente de plusieurs acteurs culturels démontre que nos institutions culturelles n’échappent pas à ces difficultés. Pour ce qui est du monde du travail, nous devons nous questionner sur nos pratiques. Saviez-vous qu’au Québec le taux de chômage est deux fois plus élevé pour la population immigrante que pour les citoyennes et citoyens nés au Canada? Et que 43 % des immigrantes et immigrants sont surqualifiés pour leur emploi, comparativement à 29,7 % des natifs du Québec?
Cette discrimination dans les milieux de travail se fait sentir avant même les entretiens d’embauche, car les personnes portant un nom de famille à consonance francophone ont 60 % plus de chance d’y être convoquées que celles dont le nom a une consonance étrangère.
Montrer l’exemple
L’État, en tant qu’employeur, se doit d’être exemplaire en termes de représentativité des personnes immigrantes qu’il emploie, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Les chiffres révélés par une enquête récente de Radio-Canada sont parlants. Parmi ses quelque 6000 salarié-es, la Société des alcools du Québec n’emploie actuellement que 38 personnes de « minorités visibles ». À Hydro-Québec, il n’y a que 312 personnes dites « de couleur » sur plus de 20 000 salarié-es. Au total, la fonction publique n’emploie que 5 % de salarié-es faisant partie des minorités visibles, alors qu’elles représentent 11 % de la population. Cette sous-représentation des personnes issues des communautés racisées ou de l’immigration au sein de la fonction publique doit être corrigée.
Le temps d’agir
Cela fait maintenant plusieurs mois que le gouvernement Couillard se dit en mode « réflexion » quant à la tenue d’une commission parlementaire sur le racisme systémique. Dans les faits, il démontre peu d’ouverture pour enclencher une véritable commission publique sur la question, disant vouloir trouver le « bon véhicule » pour aborder le sujet. Pour la CSN, ces enjeux exigent plus qu’une simple consultation en vue de se donner bonne conscience. Une commission d’enquête publique, de même envergure que celles que nous avons connues pour d’autres grandes réflexions sociales, s’impose. Et surtout, cette commission doit être organisée avec la collaboration étroite avec les communautés victimes de ce fléau.